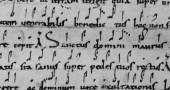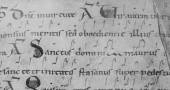PARIS,
Bibliothèque Nationale de France lat 12 584
Antiphonaire monastique (f° 216-373) complet précédé
– d’un ensemble du xve s.: martyrologe (f° 1-79), Regula
Benedicti (f° 80-119),
péricopes évangéliques des principales fêtes et des
communs (f° 120-126):
– d’un ensemble du xiie s.: graduel (f° 127-209), diverses
additions (f° 209v-216r) dont un petit tonaire (f° 216v).
et suivi d’un processional.
Temporal et sanctoral mélangés
385 folios numérotés de 1 à 385[1]. L’antiphonaire commence au f° 216.
Page: 305 x 200 mm (ais: 320 x 220)
Justification: f° 127-290, ± 245 x 145: f°
291-385, ± 270 x 145 mm.
xi-xiie siècle.
Description et contenu
Parchemin jaunâtre,
couverture xixe s.
Sur le dos rond à quatre nervures, entre la 1ere
et la 2e nervure on lit l’inscription frappée à
chaud: «Martyrologium Sancti Mauri Fossatensis».
Les marges du f° 1r portent les indications suivantes,
peut-être du xviiie
s.: «Sti Germani a Pratis n. 483, olim 1049, Sti Mauri Foss. 25»
Les folios 234, 272, 336, 397 sont
mutilés[2]
Malgré l’absence de signatures et de
réclames, les cahiers sont assez visibles en raison du mauvais
état de la reliure (xvii-xviiie s.).
Le manuscrit est complet.
|
216v |
1er dimanche de
l’Avent jusqu’aux dimanches après l’Epiphanie[3] |
|
242r |
office férial |
|
244v |
Maur puis sanctoral
d’hiver |
|
265v |
Septuagésime |
|
289v |
Pâques[4] |
|
301 |
Pentecôte |
|
303 |
Jean Baptiste puis sanctoral
d’été[5]
jusqu’à André |
|
344 |
Dédicace suivie des
communs |
|
350 |
Trinité, historiæ bibliques[6],
puis dimanches après la Pentecôte[7] |
Ecriture et notation
L’écriture du texte est une caroline du
début xiie s.
à l’encre noire sur réglure à la pointe
sèche. Chaque page comporte 26 lignes.
La notation musicale, en neumes français à
points-liés, noire, elle aussi, ne comporte pas moins de 6 mains
différentes. Les deux principales n’ont rien à voir avec
les Fossés. Elles se rattachent nettement aux notations neumatiques du
«Pays de Loire»[8]. La comparaison est éloquente[9]:
|
|
|
|
Paris BnF lat 12 584, f° 245v |
Angers, BM. 261, f° 1r |
A plusieurs reprises, le parchemin a été
gratté et on a substitué une version sur lignes (f° 275),
dans une notation connaissant le bémol (f° 276v), parfois
très proche de la notation de Paris BnF lat 12 044 (f° 276v),
parfois assez différente (f° 281). Quelques unes de ces corrections
sont toutefois restées inachevées (bas du f° 277r).
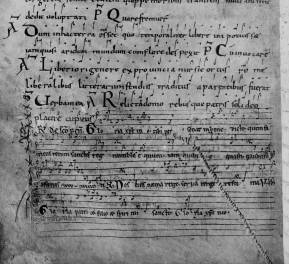
Manuscrit PARIS, BnF lat 12 584
(f° 261v, office de saint Benoît)
La correction sur 4 lignes utilise des graphies très proches
de celles de Paris BnF lat 12 044.
Titres et rubriques en onciale rouge orangé.
Initiales peintes (rouge, vert, ocre, bleu, brun). Plusieurs sont ornées
d’une remarquable décoration à base d’entrelacs, de
motifs végétaux, animaux, angéliques ou humains: 216v,
280r, 289v, 299r, 315v, etc.
Histoire du manuscrit et intérêt pour l’étude
A. Renaudin et M. Huglo ont montré que ce manuscrit n’était pas originaire de Saint-Maur des Fossés, mais bien plus probablement de Saint-Maur de Glanfeuil, abbaye du Val de Loire en contact étroit avec les Fossés du ixe au xie siècle: les deux monastères eurent même un abbé en commun, Eudes, à partir de 877[10].
Outre que F constitue l’un des plus anciens témoins français neumés de l’office monastique, il nous renseigne aussi sur l’introduction de l’organum dans le répertoire des répons et dans celui des Benedicamus Domino[11] et sur l’attitude de Cluny par rapport à ces innovations[12].
Bibliographie
A. Renaudin,
«Deux antiphonaires de Saint-Maur», EG 13 (1972), 53-150.
M. Huglo,
Les tonaires, 112, 319, 401.
M. Huglo, «Les
débuts de la polyphonie à Paris: les premiers organa parisiens»,
Forum musicologicum III, Winterthur, 1982, 94-163.
L. Deslisle, Inventaire des
manuscrits de Saint-Germain des Prés conservés à la
Bibliothèque impériale sous les numéros 11504-14231 du
fonds latin, Paris, 1868, 58.
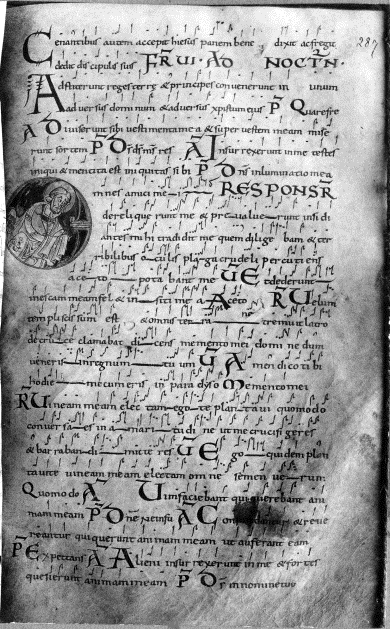
Manuscrit PARIS, BnF lat 12 584
(f° 287r, office du Vendredi saint)