MONT-RENAUD,
Collection privée
Graduel[1] relié avec un antiphonaire monastique adapté à l’usage séculier
Temporal et sanctoral mélangés.
130 folios. Pas de foliotation ancienne.
Format: 280 x 200 mm.
Justification: 230 x 145 mm.
x-xie
siècle.
Description et contenu
L’antiphonaire commence au folio
49r.
Le manuscrit comporte plusieurs
lacunes:
|
un quaternion, de la Trinité
à Benoît (11 juillet): |
96v/97r |
|
un bifolio, Eloi (1er
déc.) et commun des martyrs: |
112v/113r, 118v/119r |
|
un bifolio, commun des
confesseurs, répons de Sapientia: |
118v/119r, 123v/124r |
|
un bifolio, répons de
Machabeorum et de Psalmis: |
127v/128r |
|
un quaternion |
à la fin du manuscrit. |
Ecriture et notation
Graduel: 20 lignes par page.
Antiphonaire: 24 lignes par page.
La plus grande partie des neumes,
français, du style de ceux de Corbie[2], ont été ajoutés postérieurement par une plume au ductus
un peu fruste, mais qui traduit de nombreux détails rythmiques[3] ou mélodiques. Pas d’épisèmes ni de lettres significatives[4]. C’est ce que nous appelons la main principale.
Le manuscrit ne compte pas moins
de trois autres mains françaises et quatre mains messines supplémentaires, au
long du manuscrit[5]. La chronologie de ces diverses mains est encore
incertaine: en particulier, l’étude attentive de la superposition des neumes
français colorés (en vert au f° 47 et en rouge au f° 49v) avec des neumes
messins noirs «pourrait remettre en cause la priorité de la main principale
française défendue aux pages 26 et 27 de l’introduction…» [6].
Histoire du manuscrit et intérêt pour l’étude
La datation et l’origine du
manuscrit (rarement consulté depuis sa redécouverte) ne font pas l’unanimité[7]. Le texte – non prévu pour être noté – aurait pu être
copié dès le xe siècle,
après 920[8]. Les neumes nous orientent vers la seconde moitié du xe siècle ou le début du xie s, et la décoration vers
le xie s.[9]
L’antiphonaire, de type
monastique, a été adapté très tôt, mais en plusieurs fois[10], à l’usage séculier au moyen d’indications marginales ou
interlinéaires. Liturgiquement, certains éléments le rattachent à l'abbaye de
Saint-Denis[11]: outre la présence d’un office propre le 9 octobre (f°
104v), l’ordre des répons est proche de celui donné par la table d’antiphonaire
située à la fin de Paris Mazarine 384 (xie
s.) ou par Paris BnF lat 17 296 (xiie
s.). Par contre, son écriture musicale le rapprocherait plutôt de Corbie[12], centre avec lequel les points de contact liturgiques ne
manquent pas non plus (Paris BnF lat 11 522, du xie
s.).
La place de saint Eloi et de saint
Etienne dans les litanies et le sanctoral montrent que le manuscrit est originaire
de Noyon (monastère Saint-Eloi et sa dépendance Saint-Etienne). Comme il est
possible que les moines de Saint-Eloi de Noyon aient pu venir de Corbie, cette
dernière attribution reste aujourd’hui la plus soutenable. Elle correspond
mieux aussi aux offices propres contenus dans le manuscrit[13].
Postérieur de peu à Hartker, ce
manuscrit est le plus ancien témoin neumatique proche des traditions de
Saint-Denis/Corbie/Worcester, dont il éclairera les témoignages. La relative
diastématie de sa virga[14] et ses neumes spéciaux en font aussi une référence pour
les questions relatives à la qualité du si et aux choix si-do.
Bibliographie
Paléographie
musicale, tome 16,
Solesmes, 1955, rééd. 1989.
D. Saulnier, «Die Handschrift
von Mont-Renaud und ihre französichen Varianten», Musicologica Austriaca 14/15 (1996), 125-132.
D. Saulnier, «Les torculus du Mont-Renaud», EG
24 (1992), 135-180.
D. Saulnier, «Les climacus du
Mont-Renaud», EG 32 (2004), 147-151.
A. Walters Robertson, The ServiceBooks of the Royal Abbey of Saint-Denis, Oxford, 1991,
425-434.
M. Huglo, Les Tonaires, Paris, 1971.
91-102.
D. Escudier, «Des notations musicales dans les manuscrits non
liturgiques antérieurs au xiie
siècle», Bibliothèque de l’Ecole des chartes, 129 (1971), 27-48.
G. Beyssac, «Le graduel-antiphonaire du Mont-Renaud», Revue
de musicologie 40 (1957), 131-150.
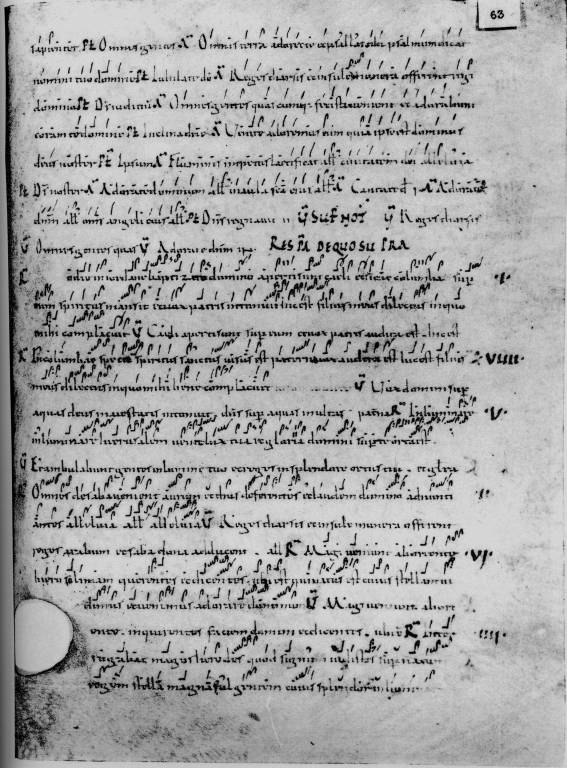
Manuscrit «du Mont-Renaud», collection privée
(f° 63r, répons de l’Epiphanie)