BENEVENTO, Biblioteca capitolare 21
Antiphonaire
monastique. Temporal et sanctoral par sections alternées.
304 folios, numérotés
de 1 à 304.
Format: 350 x 235 mm.
Justification: 294/296 x 168/172 mm.
xii-xiiie s.
Description et contenu
Mutilé du début et
de la fin, le manuscrit commence au mardi de la 2e semaine de
l’Avent. Le temporal et le sanctoral alternent par tranches successives.
Il se termine après l’office des défunts par quelques
additions (Mercure, Agathe, Jean l’Evangéliste, Assomption,
Ambroise).
Ecriture et notation
Le texte a été
copié en minuscule bénéventaine, par une main unique,
à raison de 12 lignes par page.
La notation musicale est
bénéventaine diastématique sur portée de trois
lignes de réglure à la pointe sèche. La ligne de do est colorée en rouge et la ligne de fa en jaune. Il n’y a pas de clés mais des
guidons. Pas de bémol. Pas de quilisma. Le notateur est unique.
A part trois minimes interventions
de 2e main[1], le manuscrit et sa notation sont homogènes.
Histoire du manuscrit et intérêt pour l’étude
Le manuscrit est
originaire de Bénévent, d’après son sanctoral. Mais
le scriptorium d’origine et le
monastère auquel il était destiné ne sont pas connus.
L’appellation «antiphonaire de Saint-Loup» que lui donne le CAO n’est pas documentée[2]. L’organisation du manuscrit, ses caractères
formels et sa décoration diffèrent des autres volumes de la
Bibliothèque capitulaire.
Ayant reçu très tôt le répertoire romano-franc[3], la région bénéventaine a été l’une des premières à adapter les modèles mélodiques romano-francs à de nouveaux textes. En particulier, le manuscrit comporte de nombreuses antiennes propres à la région. Certaines de ces pièces sont composées en continuité avec la tradition proprement bénéventaine[4], comme l’ antienne bénéventaine Accepta secure (f° 87v):

BENEVENTO, Biblioteca capitolare 21, f° 87v.
Les autres constituent un indice
précieux de la manière dont s’est acculturé le
répertoire romano-franc loin de son centre de naissance. De nombreux
exemples montrent que les compositeurs bénéventains
n’hésitèrent pas à prendre leurs distances par
rapport aux exigences de la rhétorique, jusqu’alors fondamentales pour
gouverner les rapports entre mélodie et texte. Ainsi dans
l’antienne Per te Maria Virgo
(tabl. 23), la mélodie provoque-t-elle dans la première partie de
la phrase, une césure malheureuse, qui contrarie la déclamation
du texte:
Per te Maria Virgo impleta sunt
prophetarum // omnium preconia…
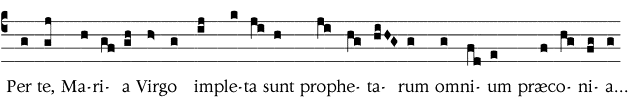
Le manuscrit est par ailleurs un
témoin important pour les questions modales liées à la
corde subsemitonale. Dans l’office comme dans le Propre de la messe, on
retrouve les sonorités du sud avec des récitations sur si et mi
conservées dans les modes 3, 4, 7 et 8.
Bibliographie
Paléographie
musicale 21 (1992), 338-341, pl.
32-59.
Paléographie
musicale 22 (2002): fac-similé
complet, description codicologique et tables.
J. Mallet et A. Thibaut. Les manuscrits en écriture
bénéventaine de la Bibliothèque capitulaire de
Bénévent,
tome 2, p. 71-75 pour la description; et tome 3, passim.
T.F. Kelly, The Beneventan Chant, Cambridge, 1989.
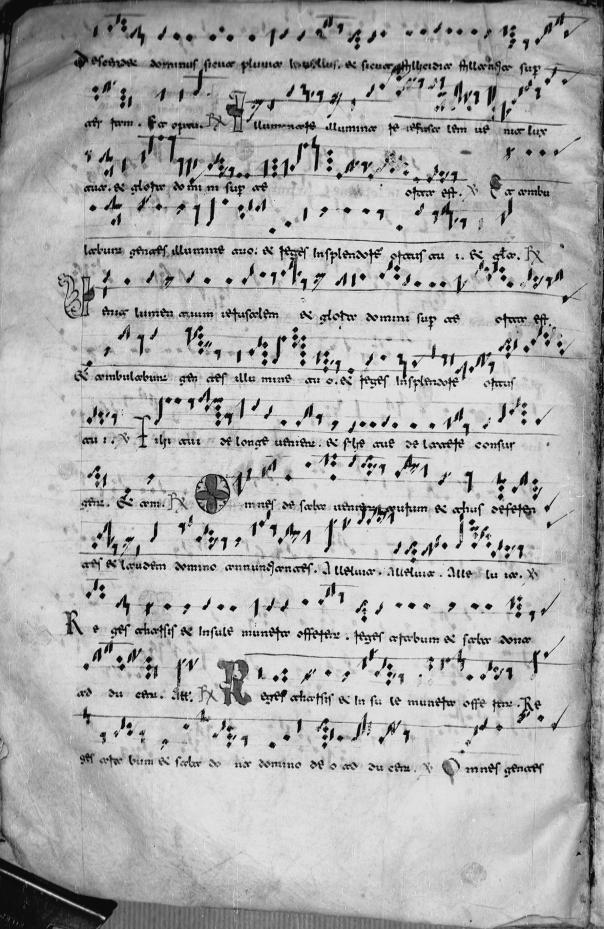
BENEVENTO,
Biblioteca capitolare, cod. 21, f° 39v
(répons de l’Epiphanie)